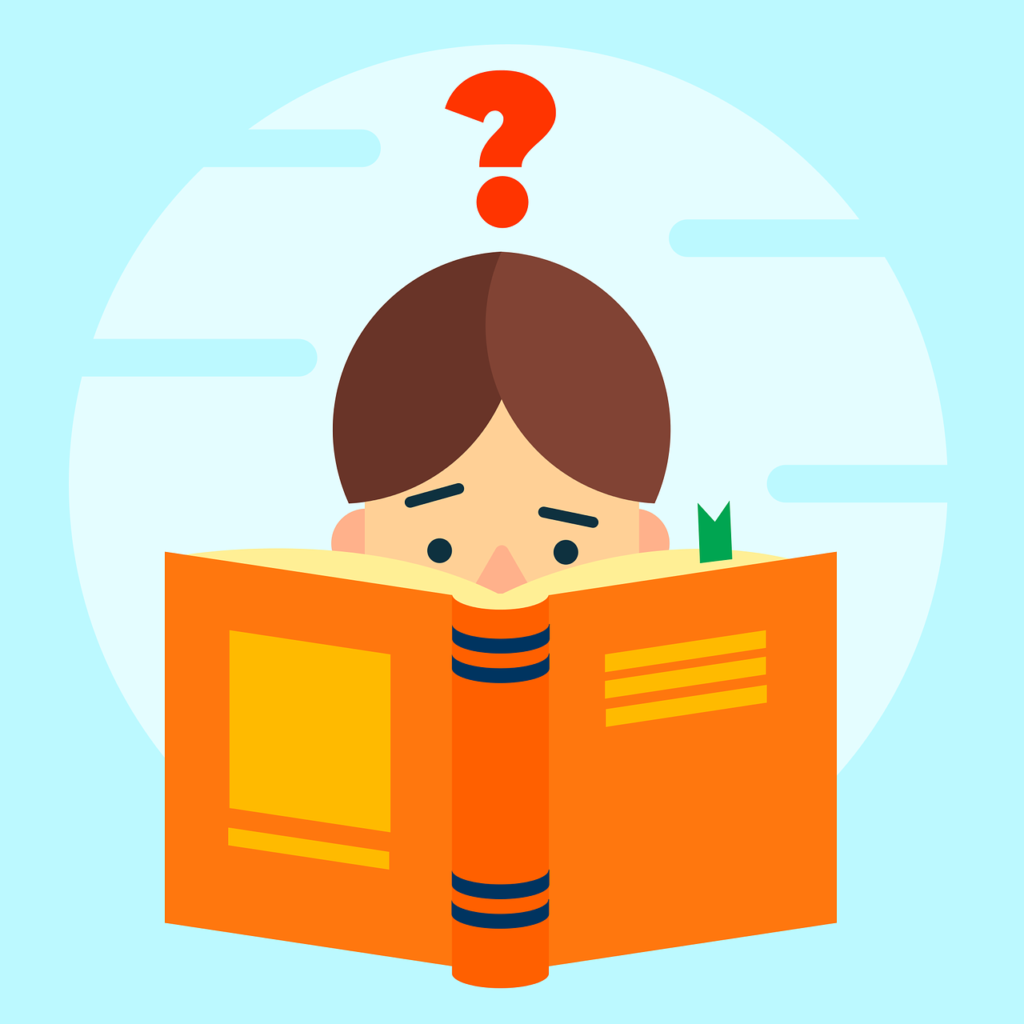Afin d’apporter des éléments de réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Nous posterons régulièrement sur le site internet des questions / réponses. Ces argumentaires, proposés par le Ministère de la Transition Ecologique, concernent l’éolien. Voici la première partie :
« Les éoliennes produisent très peu » -> C’est relatif
Une seule éolienne de 2 MW (représentative du parc éolien français en service) produit environ 4 000 MWh par an, c’est l’équivalent de la consommation d’électricité de plus de 800 foyers !
En 2020, les 8 000 éoliennes françaises ont produit 40 TWh, cela correspond à la consommation électrique de près de 8 millions de foyers.
En 2020, le parc éolien a produit 8,8 % de la consommation nationale d’électricité sur l’année, contre 7,2 % en 2019. Dans un avenir proche, l’énergie éolienne jouera un rôle essentiel : en 2030, l’énergie éolienne pourrait devenir la première source d’électricité renouvelable en France, devant l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie hydraulique, ce qui permettrait à la France d’atteindre plus de 40 % d’électricité d’origine renouvelable dans sa production.
Les énergies renouvelables en général, et l’éolien en particulier, ont montré leur résilience durant la crise sanitaire.
Leur production n’a été que faiblement impactée, participant ainsi à la sécurité d’approvisionnement en électricité.
En mars 2020, la part d’énergies renouvelables a pu atteindre certains jours 35 % en moyenne (le 29 mars 2020 par exemple), sans quelconque impact négatif sur le système électrique. Le taux de couverture des énergies renouvelables a même atteint un pic le vendredi 5 juin 2020 avec une valeur de 52,9 % en fin de journée.
« On ne peut pas dire que la production éolienne permet d’alimenter des foyers en énergie car il s’agit d’une production intermittente, qui ne peut suffire aux besoins des consommateurs » -> Pas si simple / Faux
Il est exact qu’une éolienne ne produit pas en permanence et ne permet pas à elle seule de répondre aux besoins des consommateurs.
Mais c’est également le cas pour toutes les formes de production d’énergie : le photovoltaïque produit plus à midi, l’hydroélectricité produit en fonction de la disponibilité de l’eau, les installations nucléaires et thermiques (ainsi que les éoliennes, les installations solaires et les barrages hydroélectriques) doivent être arrêtées régulièrement pour des opérations de maintenance qui peuvent durer jusqu’à plusieurs mois. Aucune installation de production d’électricité n’est donc à même d’assurer la sécurité d’approvisionnement des consommateurs à elle seule.
Le fonctionnement du système électrique nécessite donc la disponibilité d’une variété d’installations, de plusieurs technologies différentes, réparties sur l’ensemble du territoire, et d’un réseau fonctionnel et interconnecté avec nos voisins européens. Par ailleurs, s’agissant de l’éolien, disposer de nombreuses installations réparties sur l’ensemble du territoire contribue réellement à la sécurité d’approvisionnement car les régimes de vent sont différents selon les régions, ce qui permet de disposer à tout instant d’une capacité réelle de production éolienne.
En France, la production éolienne présente d’ailleurs certaine complémentarité avec la consommation puisqu’elle est statistiquement plus importante entre octobre et mars [voir bilan électrique de RTE], lorsque les besoins sont les plus importants.
« Développer de l’éolien en France ne sert à rien car nous avons du nucléaire » -> Faux
La production électrique française repose aujourd’hui à plus de 70 % sur le nucléaire et la France a fait le choix de diversifier ses sources d’approvisionnement.
La diversification des moyens de production d’électricité sert de nombreux objectifs et notamment la réduction de la dépendance énergétique du pays aux importations énergétiques (uranium, pétrole, gaz) et le renforcement de la sécurité d’approvisionnement (un mix diversifié est plus résilient, car il ne repose pas quasi exclusivement sur une seule technologie). De plus, le développement des énergies renouvelables permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (cf. idée reçue suivante).
L’énergie nucléaire est une énergie dite décarbonée mais elle n’est pas renouvelable puisqu’elle utilise l’uranium comme combustible. Son utilisation pose aussi la question des déchets radioactifs, au-delà de la résilience de notre système électrique.
C’est pourquoi la France s’est fixé l’objectif de ramener la part du nucléaire au sein du mix électrique à 50 % à l’horizon 2035, contre environ 71 % actuellement.
La crise sanitaire a montré qu’il était essentiel de pouvoir disposer de sources de production d’électricité qui ne nécessitent pas une présence humaine en continue et de ne pas dépendre très majoritairement d’une technologie de production, susceptible de connaitre un aléa générique.
« Développer de l’éolien en France ne sert à rien pour le climat car notre électricité est déjà décarbonée » -> FAUX
Les règles d’appel aux installations de production électrique font que la production éolienne est intégrée sur le réseau en priorité par rapport aux installations utilisant des combustibles fossiles.
RTE a estimé que le développement des énergies renouvelables (PV et éolien) permet d’éviter chaque année 22 millions de tonnes d’émissions de CO2 au niveau européen soit les émissions annuelles d’environ 12 millions de véhicules.
RTE confirme l’intérêt de l’accroissement des renouvelables dans le mix électrique : « Dans la plupart des cas, la croissance de la production renouvelable en France aura pour effet de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et concourront donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne. » (bilan prévisionnel 2019)
Lorsqu’elles fonctionnent, les éoliennes françaises se substituent principalement à des installations de production utilisant des combustibles fossiles en France ou en Europe. Ainsi, lorsqu’une éolienne fonctionne, son électricité se substitue pour 55 % à de l’électricité produite par des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles situées en France et pour 22 % à de l’électricité produite par de telles centrales à l’étranger. Ainsi chaque kWh d’éolien a permis d’éviter 430 g de CO2 en France et en Europe.
Rapporté à sa durée de vie et en intégrant les étapes nécessaires à sa fabrication, un kWh produit par une éolienne représente une émission d’environ 14 à 18 g de CO2, contre environ 350 g pour une centrale à gaz et 1 000 g pour une centrale à charbon. Les émissions de CO2 du mix électrique français varient entre 40 et 80 gCO2/kWh selon les années.
« L’éolien, variable, implique un recours accru aux énergies fossiles pilotables » -> FAUX
D’ici à 2035, l’intégration de nouvelles installation éoliennes et photovoltaïques ne nécessitera pas un recours accru au charbon ou au gaz, au contraire.
Le système électrique français est suffisamment flexible pour les accueillir en raison de son parc hydroélectrique et nucléaire et des possibilités de piloter la demande.
Pour prendre en compte la production variable des énergies renouvelables, les analyses de RTE ont conclu à plusieurs reprises que le développement de l’éolien et du photovoltaïque prévu dans les dix prochaines années en France dans le cadre de la PPE pourront s’appuyer sur la flexibilité du système électrique français, sur sa capacité à piloter la consommation (comme cela est fait avec 7 millions de ballons d’eau chaude), mais aussi sur les nombreuses interconnexions disponibles avec nos voisins européens. Si au-delà, un développement du stockage et des flexibilités sera nécessaire, tel n’est pas le cas avec les objectifs de notre PPE.